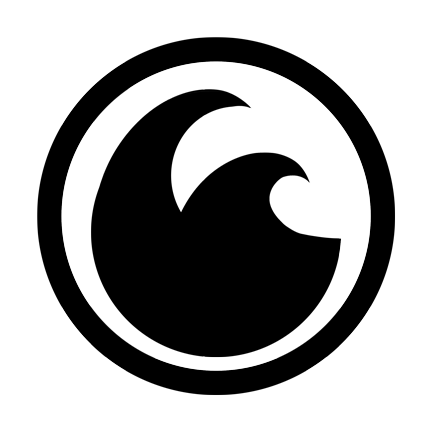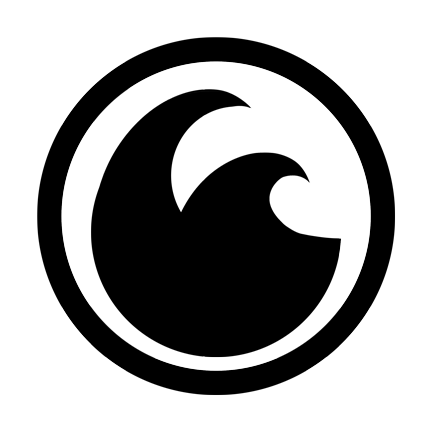L’amplitude du tsunami généré augmente avec la magnitude du séisme. A partir d’une magnitude 8, le séisme peut générer un tsunami potentiellement dévastateur au niveau d’une mer ou d’un bassin océanique.
Des modélisations réalisées par le BRGM montrent qu’un tsunami issu d’un glissement ou effondrement sous‑marin pourrait atteindre le littoral en moins d’une heure.
Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs survenus au large des côtes françaises, italiennes et du Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.
Les séismes dont la magnitude dépasse 8,7 comme celui du Japon du 11 mars 2011 et celui de Sumatra du 26 décembre 2004 (Mw 9,2) induisent des tsunamis majeurs qui provoquent des inondations le long des côtes de tout le bassin océanique concerné.
La France continentale, notamment la côte atlantique, reste vulnérable à des tsunamis transatlantiques, comme celui de 1755 suite au séisme de Lisbonne.
Un réseau instrumenté (sismographes, marégraphes) permet une détection en continu, alimentant le Centre d’Alerte pour enclencher des plans ORSEC si besoin.
Le dispositif d’alerte s’appuie sur les autorités, les sirènes locales, le Centre d’Alerte aux Tsunamis et les médias, pour transmettre rapidement les consignes.
Un tsunami est provoqué par un séisme sous marin ou côtier se produisant à faible profondeur (moins de 50 km de profondeur) et possédant une magnitude d’au moins 6,5.