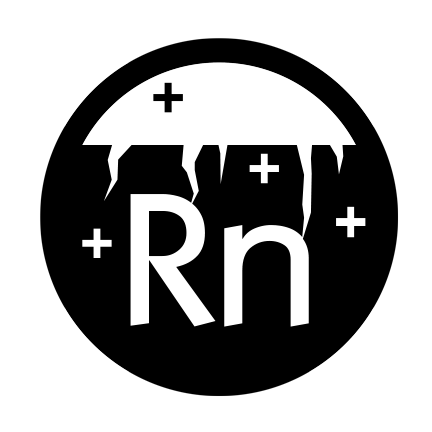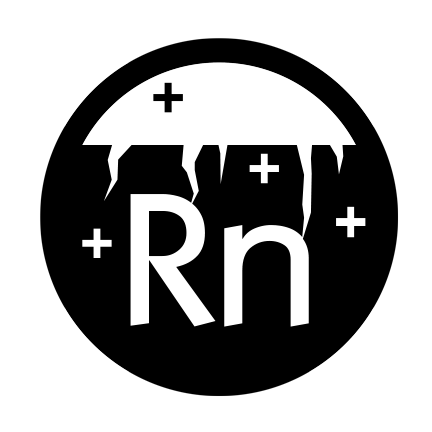Dans le département de la Loire, toutes les communes sont classées en zone 1, ce qui signifie un potentiel radon considéré comme faible selon la carte nationale de l’IRSN basée sur les formations géologiques locales.
Dans les communes corréziennes classées en zone 3, les établissements recevant du public doivent établir un mesurage du radon et renouveler ces mesures périodiquement si les résultats dépassent les seuils réglementaires.
Une aération quotidienne de dix minutes est recommandée pour évacuer efficacement le radon des logements, bien que seule une mesure réalisée avec un détecteur sur plusieurs semaines puisse confirmer un dépassement significatif.
Dans plusieurs zones de Haute‑Vienne, les anciennes maisons avec cave en terre battue ou dalle sur terre‑plein présentent souvent des taux de radon supérieurs à 300 Bq/m³, favorisés par une ventilation insuffisante et un sous‑sol fissuré.
Les réglementations imposent à tout vendeur ou bailleur d’informer l’acheteur ou le locataire du classement en zone 3, une obligation applicable dans toute la Haute‑Vienne pour les biens immobiliers concernés.
Les campagnes régionales “Du radon dans ma maison ?” organisées en Alsace, dans les Vosges ou autour de Saint‑Dié‑des‑Vosges, visent à sensibiliser les habitants des communes classées en zone 3 avec distribution de dosimètres dans les maisons individuelles.
Les pratiques simples comme ouvrir les fenêtres au minimum dix minutes par jour, entretenir un système de ventilation et colmater les fissures favorisent une qualité de l’air intérieur plus saine.
Dans le département, la réduction de l’exposition au radon passe aussi par des conseils pour l’entretien du bâti ancien : reboucher les fissures de planchers, vérifier les vides sanitaires et améliorer l’aération naturelle des pièces.