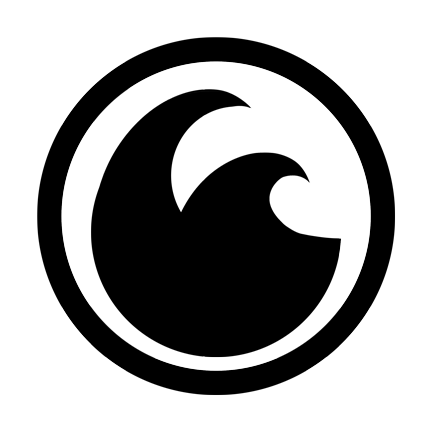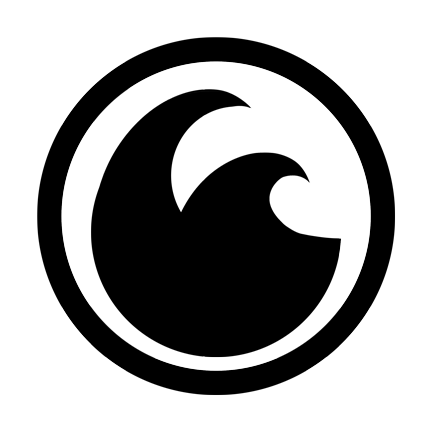Les zones basses proches du littoral et les plages sont les plus exposées. Repérer en amont les itinéraires vers les hauteurs peut faire gagner un temps précieux.
En cas d’alerte tsunami, la collectivité peut déclencher des sirènes, des messages via FR‑Alert, et informer via les médias locaux.
Les secteurs côtiers plats, les plages et embouchures de rivière sont particulièrement exposés. Il vaut mieux identifier en avance les chemins vers la hauteur.
Des cartes d’inondation et des plans d’évacuation ont été élaborés pour repérer les zones les plus vulnérables et guider les habitants en cas de menace.
Un plan familial simple – points hauts repérés, sac d’urgence prêt, consignes connues – aide les familles à réagir efficacement.
Une secousse puissante ou prolongée, un bruit sourd et inhabituel ou encore une chute rapide du niveau de la mer ou le retrait rapide de la mer sont des signes naturels avant coureurs de l’arrivée imminente de vagues de tsunami. Dans ce cas, évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la diffusion d’une alerte officielle !
Un séisme ressenti, la mer qui se retire ou un grondement inhabituel doivent immédiatement inciter à se réfugier sur un point haut.
Des modélisations réalisées par le BRGM montrent qu’un tsunami issu d’un glissement ou effondrement sous‑marin pourrait atteindre le littoral en moins d’une heure.