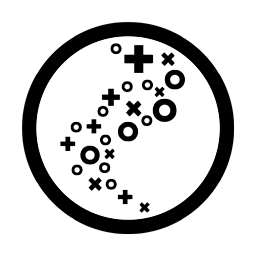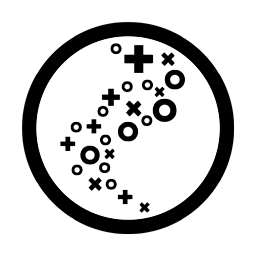Les épisodes de brume de sable sur la Martinique sont généralement signalés avec un délai de prévision de 48 à 72 heures, ce qui permet aux services concernés de diffuser les consignes adaptées.
Le territoire dispose de stations fixes capables de mesurer en continu les particules fines, ce qui permet d’anticiper les épisodes de pollution et d’ajuster les messages de prévention.
En cas de pic de pollution à l’ozone concomitant à une canicule, les résultats des analyses menées en 2003 montrent que les risques liés aux fortes températures sont beaucoup plus importants que le risque lié à l’ozone. Il faut donc en priorité se protéger de la chaleur.
Les pics de pollution atmosphérique en Martinique sont principalement dus à la présence de poussières sahariennes, mais aussi à des émissions locales liées au trafic, aux activités portuaires ou aux brûlages agricoles.
Selon l’OMS, la pollution de l’air est le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Ainsi, l’exposition à la pollution de l’air extérieur conduit chaque année au décès d’environ 4,2 millions de personnes dans le monde.
Lors des épisodes de brume de sable en Martinique, les concentrations de particules PM10 dépassent parfois les seuils réglementaires, entraînant une alerte de niveau orange ou rouge transmise par les services de surveillance.
Lors de certains épisodes de pollution en Loire-Atlantique, généralement causés par des conditions météorologiques stables ou un trafic routier dense, l’indice de qualité de l’air (AQI) peut atteindre des niveaux de 50 à 60, ce qui nécessite des précautions pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires.
Les principales sources de pollution de l'air extérieur comprennent l'énergie domestique utilisée pour la cuisson et le chauffage, les véhicules, la production d'électricité, l'agriculture, l'incinération des déchets et l'industrie.