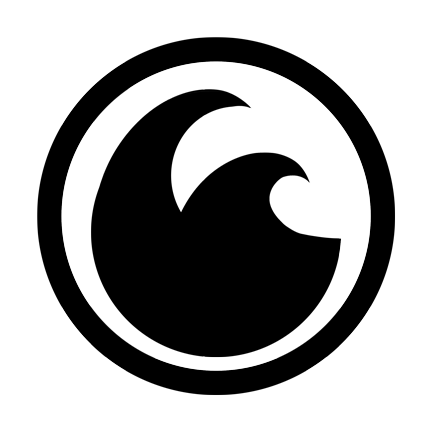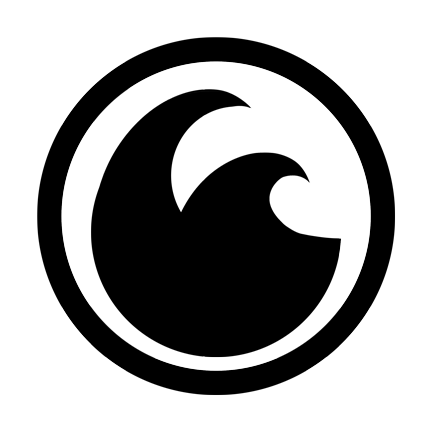Une secousse puissante ou prolongée, un bruit sourd et inhabituel ou encore une chute rapide du niveau de la mer ou le retrait rapide de la mer sont des signes naturels avant coureurs de l’arrivée imminente de vagues de tsunami. Dans ce cas, évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la diffusion d’une alerte officielle !
Le littoral abrite près de 75 % de la population sur moins de 1 km de large, ce qui augmente la vulnérabilité et justifie des dispositifs d’alerte renforcés.
La France continentale, notamment la côte atlantique, reste vulnérable à des tsunamis transatlantiques, comme celui de 1755 suite au séisme de Lisbonne.
La cartographie officielle identifie les zones à évacuer et s’appuie sur une modélisation hydraulique, mais des projets comme TSUCAL visent à affiner cette cartographie avec des scénarios plus précis.
Les sirènes installées en zone urbaine (Nouméa notamment) sont testées régulièrement pour s’assurer de leur fonctionnement et de la sensibilisation de la population.
Un tsunami est provoqué par un séisme sous marin ou côtier se produisant à faible profondeur (moins de 50 km de profondeur) et possédant une magnitude d’au moins 6,5.
Les séismes dont la magnitude dépasse 8,7 comme celui du Japon du 11 mars 2011 et celui de Sumatra du 26 décembre 2004 (Mw 9,2) induisent des tsunamis majeurs qui provoquent des inondations le long des côtes de tout le bassin océanique concerné.
Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs survenus au large des côtes françaises, italiennes et du Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.