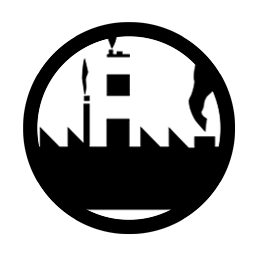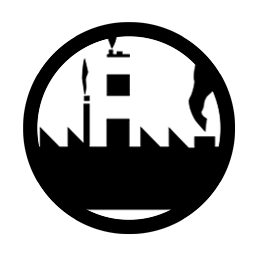Les industries pétrochimiques produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Un risque industriel majeur est la probabilité d'un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l'environnement.
Un accident industriel majeur peut altérer l’outil économique d’une zone. Les entreprises, les réseaux d’eaux, téléphonique et électrique, les routes ou voies de chemin de fer voisines du lieu de l’accident peuvent être détruits ou gravement endommagés.
La mise en œuvre des PPRT autour des sites Seveso, notamment à Lavera ou Fos‑sur‑Mer, impose des servitudes d’urbanisme qui encadrent l’implantation de nouvelles constructions à proximité des sites industriels à risque.
Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion.
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.
On distingue deux niveaux, seuil haut et seuil bas, afin que les mesures soient adaptées à la taille et au type d’établissement grâce à une étude de dangers réalisée pour chaque établissement. Ils sont ensuite soumis à des contrôles fréquents et des exercices de simulation.
Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés dangereux, c'est-à-dire dans les industries chimiques (engrais, produits pharmaceutiques, eau de javel) et les industries pétrochimiques (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfie).