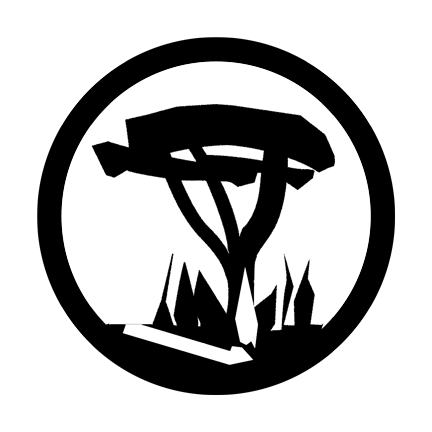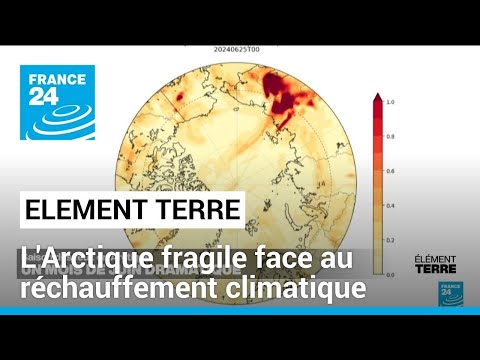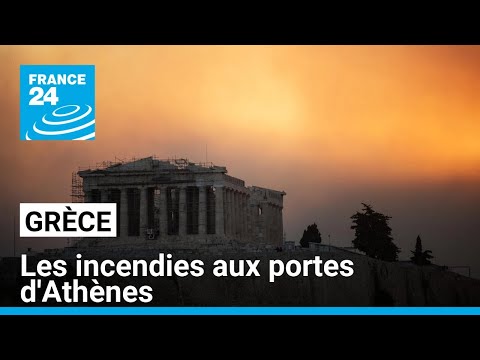Autour de Nay et Mauléon, des zones boisées sont classées à risque par le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies, imposant des obligations de débroussaillement aux riverains.
À Urt ou Saint-Pée‑sur‑Nivelle, la faible couverture des Camions‑Citerne Grande Capacité impose une vigilance renforcée lors des alertes feu, selon les orientations de lutte définies par le SDIS.
Un simple geste peut détruire des habitations, des entreprises et des campings, menacer des vies humaines, avoir de graves conséquences sur la nature et tuer des animaux.
Des opérations d’installation de pare‑feux et d’aménagement de pistes DFCI sont réalisées autour des massifs proches de Saint-Jean-de-Luz, afin d’améliorer l’accès des secours et réduire la propagation du feu.
Les établissements publics de villes comme Pau ou Bayonne reçoivent des messages de prévention avant l’été, notamment sur les gestes à éviter en période de sécheresse et de vent.
À Oloron-Sainte‑Marie, les documents départementaux recommandent d’entretenir une zone débroussaillée d’au moins cinquante mètres autour des maisons situées à proximité des espaces boisés.
À Abidos ou Pardies, les zones industrielles proches des forêts sont couvertes par un PPRCI permettant de limiter les risques de propagation en cas d’incendies technologiques ou naturels.
Jettez les mégots dans un cendrier. Ne fumez pas en forêt.